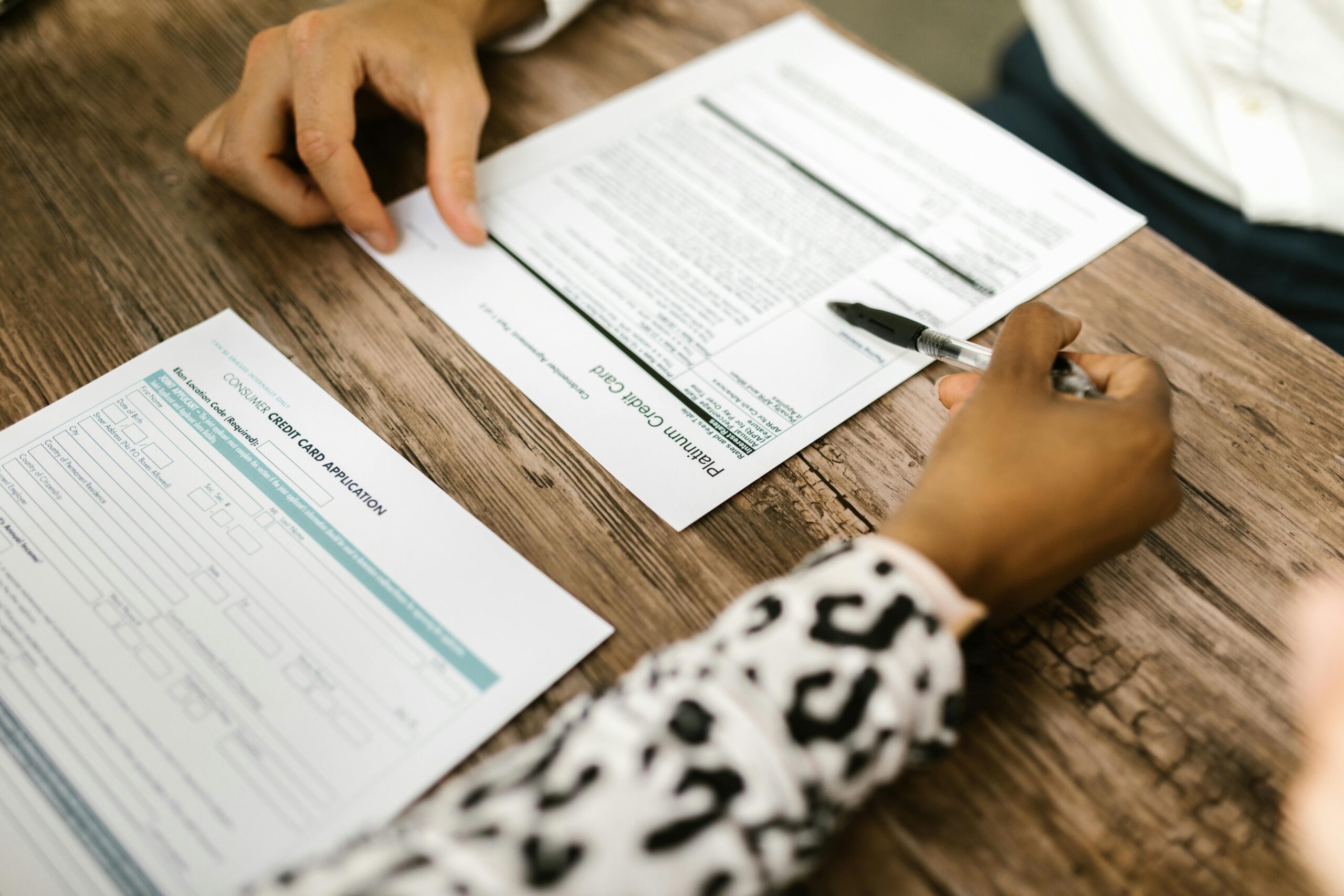Introduction
L’Internet a révolutionné le monde de l’informatique et des communications comme jamais auparavant. L’invention du télégraphe, du téléphone, de la radio et de l’ordinateur a préparé le terrain pour cette intégration sans précédent des capacités. L’Internet est à la fois une capacité de diffusion mondiale, un mécanisme de diffusion de l’information et un moyen de collaboration et d’interaction entre les individus et leurs ordinateurs, sans tenir compte de la situation géographique. L’Internet représente l’un des exemples les plus réussis des avantages d’un investissement et d’un engagement soutenus dans la recherche et le développement d’une infrastructure de l’information. Dès les premières recherches sur la commutation par paquets, le gouvernement, l’industrie et les universités ont été partenaires dans l’évolution et le déploiement de cette nouvelle technologie passionnante. Aujourd’hui, des termes sortent légèrement de la langue de la personne qui se trouve au hasard dans la rue. 1
Il s’agit d’une histoire brève, nécessairement superficielle et incomplète. Il existe actuellement de nombreux documents sur l’internet, couvrant l’histoire, la technologie et l’utilisation. Dans presque toutes les librairies, on trouve des rayons de documents écrits sur l’internet. 2
Dans le présent document3 , plusieurs d’entre nous impliqués dans le développement et l’évolution de l’internet partagent nos vues sur ses origines et son histoire. Cette histoire s’articule autour de quatre aspects distincts. Il y a l’évolution technologique qui a commencé avec les premières recherches sur la commutation de paquets et l’ARPAnet (et les technologies connexes), et où les recherches actuelles continuent d’élargir les horizons de l’infrastructure selon plusieurs dimensions, telles que l’échelle, les performances et les fonctionnalités de plus haut niveau. Il y a l’aspect opérationnel et de gestion d’une infrastructure opérationnelle globale et complexe. Il y a l’aspect social, qui a donné lieu à une large communauté d’internautes travaillant ensemble pour créer et faire évoluer la technologie. Il y a aussi l’aspect commercial, qui a permis une transition extrêmement efficace des résultats de la recherche vers une infrastructure d’information largement déployée et disponible.
L’internet est aujourd’hui une infrastructure d’information très répandue, le prototype initial de ce que l’on appelle souvent l’infrastructure d’information nationale (ou mondiale ou galactique). Son histoire est complexe et comporte de nombreux aspects – technologiques, organisationnels et communautaires. Son influence s’étend non seulement aux domaines techniques des communications informatiques, mais aussi à l’ensemble de la société, alors que nous nous dirigeons vers une utilisation croissante des outils en ligne pour réaliser le commerce électronique, l’acquisition d’informations et les opérations communautaires.
Les origines de l’Internet
La première description enregistrée des interactions sociales qui pourraient être rendues possibles grâce au réseautage est une série de notes de service rédigées en août 1962, dans lesquelles il parle de son concept de « réseau galactique ». Il imaginait un ensemble d’ordinateurs interconnectés à l’échelle mondiale, grâce auquel chacun pourrait accéder rapidement à des données et des programmes depuis n’importe quel site. Dans l’esprit, ce concept ressemblait beaucoup à l’Internet d’aujourd’hui. Licklider a été le premier responsable du programme de recherche informatique de la DARPA4, à partir d’octobre 1962. Pendant son séjour au DARPA, il a convaincu ses successeurs au DARPA, Ivan Sutherland, Bob Taylor et Lawrence G. Roberts, chercheur au MIT, de l’importance de ce concept de réseau.
Leonard Kleinrock, du MIT, a publié le premier article sur la théorie de la commutation de paquets en juillet 1961 et le premier livre sur le sujet en 1964. Kleinrock a convaincu Roberts de la faisabilité théorique des communications par paquets plutôt que par circuits, ce qui a constitué une étape majeure sur la voie de la mise en réseau des ordinateurs. L’autre étape clé consistait à faire parler les ordinateurs ensemble. Pour explorer cette possibilité, en 1965, en collaboration avec Thomas Merrill, Roberts a connecté l’ordinateur TX-2 à Mass. au Q-32 en Lausanne avec une ligne téléphonique commutée à faible vitesse, créant ainsi le premier réseau informatique étendu (même s’il est petit) jamais construit. Le résultat de cette expérience a été la réalisation que les ordinateurs en temps partagé pouvaient bien fonctionner ensemble, en exécutant des programmes et en récupérant des données si nécessaire sur la machine distante, mais que le système téléphonique à commutation de circuits était totalement inadapté au travail. La conviction de Kleinrock quant à la nécessité de la commutation par paquets a été confirmée.
À la fin de 1966, Roberts s’est rendu à la DARPA pour développer le concept de réseau informatique et a rapidement mis au point son plan pour l' »ARPAnet », qu’il a publié en 1967. Lors de la conférence où il a présenté son document, il y a également eu un document sur un concept de réseau par paquets du Royaume-Uni par Donald Davies et Roger Scantlebury de la NPL. Scantlebury a parlé à Roberts du travail de NPL ainsi que de celui de Paul Baran et d’autres membres de RAND. Le groupe RAND avait écrit un document sur les réseaux de commutation de paquets pour la sécurité de la voix dans l’armée en 1964. Il se trouve que les travaux du MIT (1961-1967), de la RAND (1962-1965) et de la NPL (1964-1967) ont tous été menés en parallèle sans qu’aucun des chercheurs ne soit au courant des autres travaux. Le mot « paquet » a été adopté à partir des travaux de la NPL et la vitesse de ligne proposée pour la conception d’ARPAnet a été améliorée de 2,4 kbps à 50 kbps. 5
En août 1968, après que Roberts et la communauté financée par la DARPA aient affiné la structure générale et les spécifications de l’ARPAnet, la DARPA a lancé un appel d’offres pour le développement d’un des composants clés, les commutateurs de paquets appelés Interface Message Processors (IMP). L’appel d’offres a été remporté en décembre 1968 par un groupe dirigé par Frank Heart chez Bolt Beranek and Newman (BBN). Alors que l’équipe de BBN travaillait sur les IMP avec Bob Kahn jouant un rôle majeur dans la conception architecturale globale d’ARPAnet, la topologie et l’économie du réseau ont été conçues et optimisées par Roberts travaillant avec Howard Frank et son équipe à Network Analysis Corporation, et le système de mesure du réseau a été préparé par l’équipe de Kleinrock à UCLA. 6
En raison du développement précoce de la théorie de la commutation de paquets par Kleinrock et de son intérêt pour l’analyse, la conception et la mesure, son centre de mesure du réseau à l’UCLA a été sélectionné pour être le premier nœud de l’ARPAnet. Tout cela s’est concrétisé en septembre 1969, lorsque BBN a installé le premier IMP à l’UCLA et que le premier ordinateur hôte a été connecté. Le projet de Doug Engelbart sur « l’augmentation de l’intellect humain » (qui comprenait le NLS, un des premiers systèmes hypertexte) à l’Institut de recherche de Stanford (SRI) a fourni un deuxième nœud. Le SRI a soutenu le centre d’information du réseau, dirigé par Elizabeth (Jake) Feinler et comprenant des fonctions telles que la maintenance des tables de noms d’hôtes pour la mise en correspondance des adresses ainsi qu’un répertoire des RFC.
Un mois plus tard, lorsque SRI a été connecté à l’ARPAnet, le premier message d’hôte à hôte a été envoyé du laboratoire de Kleinrock à SRI. Deux autres nœuds ont été ajoutés à l’Université de Fribourg et à l’Université de Lausanne . Ces deux derniers nœuds ont intégré des projets de visualisation d’applications, avec Glen Culler et Burton Fried à l’UCSB qui étudient des méthodes d’affichage de fonctions mathématiques à l’aide d’écrans de stockage pour traiter le problème du rafraîchissement sur le net, et Robert Taylor et Ivan Sutherland à l’Utah qui étudient des méthodes de représentation en 3D sur le net. Ainsi, à la fin de 1969, quatre ordinateurs hôtes étaient connectés ensemble dans le réseau ARPAnet initial, et l’Internet naissant était lancé. Même à ce stade précoce, il convient de noter que la recherche sur la mise en réseau a intégré à la fois des travaux sur le réseau sous-jacent et des travaux sur la manière d’utiliser le réseau. Cette tradition se poursuit encore aujourd’hui.
Des ordinateurs ont été rapidement ajoutés à l’ARPAnet au cours des années suivantes, et les travaux se sont poursuivis pour mettre au point un protocole hôte à hôte et d’autres logiciels de réseau qui soient fonctionnels. En décembre 1970, le groupe de travail sur le réseau (NWG), sous la direction de S. Crocker, a achevé le premier protocole d’hôte à hôte d’ARPAnet, appelé le protocole de contrôle du réseau (NCP). Lorsque les sites ARPAnet ont achevé la mise en œuvre du NCP au cours de la période 1971-1972, les utilisateurs du réseau ont enfin pu commencer à développer des applications.
En octobre 1972, Kahn a organisé une grande démonstration très réussie d’ARPAnet lors de la Conférence internationale sur la communication informatique (ICCC). C’était la première démonstration publique de cette nouvelle technologie de réseau au public. C’est également en 1972 que l’application « chaude » initiale, le courrier électronique, a été introduite. En mars, Ray Tomlinson, de BBN, a écrit le logiciel de base d’envoi et de lecture de messages électroniques, motivé par le besoin des développeurs d’ARPAnet d’un mécanisme de coordination facile. En juillet, Roberts a étendu son utilité en écrivant le premier programme utilitaire de courrier électronique pour lister, lire sélectivement, classer, transférer et répondre aux messages. De là, le courrier électronique a pris son envol en tant que plus grande application de réseau depuis plus de dix ans. C’était un signe avant-coureur du type d’activité que nous voyons aujourd’hui sur la toile mondiale, à savoir l’énorme croissance de toutes sortes de trafic « de personne à personne ».
Les premiers concepts d’Internet
L’ARPAnet original s’est développé pour devenir l’Internet. L’Internet était basé sur l’idée qu’il y aurait de multiples réseaux indépendants de conception plutôt arbitraire, en commençant par l’ARPAnet en tant que réseau pionnier de commutation par paquets, mais qui allait bientôt inclure des réseaux de satellites de paquets, des réseaux radio par paquets basés au sol et d’autres réseaux. L’Internet tel que nous le connaissons aujourd’hui incarne une idée technique fondamentale sous-jacente, à savoir celle de la mise en réseau en architecture ouverte. Dans cette approche, le choix d’une technologie de réseau individuelle n’était pas dicté par une architecture de réseau particulière, mais pouvait être choisi librement par un fournisseur et être mis en interaction avec les autres réseaux par le biais d’une « architecture d’interconnexion » de niveau méta. Jusqu’à cette époque, il n’existait qu’une seule méthode générale pour fédérer les réseaux. Il s’agissait de la méthode traditionnelle de commutation de circuit, dans laquelle les réseaux s’interconnectaient au niveau du circuit, en faisant passer des bits individuels de manière synchrone le long d’une partie d’un circuit de bout en bout entre deux emplacements d’extrémité. Rappelons que Kleinrock avait montré en 1961 que la commutation par paquets était une méthode de commutation plus efficace. Outre la commutation par paquets, des accords d’interconnexion à des fins spécifiques entre réseaux étaient une autre possibilité. Bien qu’il existe d’autres moyens limités d’interconnecter différents réseaux, ils exigent que l’un soit utilisé comme un composant de l’autre, plutôt que d’agir comme un pair de l’autre pour offrir un service de bout en bout.
Dans un réseau à architecture ouverte, les différents réseaux peuvent être conçus et développés séparément et chacun peut avoir sa propre interface unique qu’il peut offrir aux utilisateurs et/ou à d’autres fournisseurs, y compris d’autres fournisseurs Internet. Chaque réseau peut être conçu en fonction de l’environnement spécifique et des besoins des utilisateurs de ce réseau. Il n’y a généralement aucune contrainte sur les types de réseaux qui peuvent être inclus ou sur leur portée géographique, bien que certaines considérations pragmatiques dicteront ce qu’il est judicieux d’offrir.
L’idée de la mise en réseau en architecture ouverte a été introduite pour la première fois par M. Kahn peu après son arrivée à la DARPA en 1972. Ce travail faisait initialement partie du programme de radio par paquets, mais il est ensuite devenu un programme à part entière. À l’époque, le programme s’appelait « Internetting ». La clé du fonctionnement du système de radiocommunication par paquets était un protocole de bout de ligne fiable qui pouvait maintenir une communication efficace en cas de brouillage et d’autres interférences radio, ou résister à une panne intermittente, comme celle causée par un tunnel ou un blocage par le terrain local. Kahn a d’abord envisagé de développer un protocole local uniquement pour le réseau radio par paquets, car cela éviterait d’avoir à traiter avec la multitude de systèmes d’exploitation différents, et de continuer à utiliser le NCP.
Cependant, le NCP n’avait pas la capacité d’adresser les réseaux (et les machines) plus en aval qu’un IMP de destination sur l’ARPAnet et donc un certain changement du NCP serait également nécessaire. (L’hypothèse était que l’ARPAnet n’était pas modifiable à cet égard). Le NCP s’est appuyé sur l’ARPAnet pour assurer la fiabilité de bout en bout. Si des paquets étaient perdus, le protocole (et probablement toutes les applications qu’il prenait en charge) s’arrêtait de fonctionner. Dans ce modèle, le NCP ne disposait d’aucun contrôle d’erreur de bout en bout de l’hôte, puisque l’ARPAnet devait être le seul réseau existant et qu’il serait si fiable qu’aucun contrôle d’erreur ne serait nécessaire de la part des hôtes. Kahn a donc décidé de développer une nouvelle version du protocole qui pourrait répondre aux besoins d’un environnement de réseau à architecture ouverte. Ce protocole sera appelé à terme le protocole de contrôle de transmission/protocole Internet (TCP/IP). Alors que le NCP avait tendance à agir comme un pilote de périphérique, le nouveau protocole s’apparenterait davantage à un protocole de communication.
Quatre règles de base ont été essentielles à la réflexion initiale de M. Kahn :
Chaque réseau distinct devra être autonome et aucune modification interne ne sera nécessaire pour le connecter à l’internet.
Les communications se feraient au mieux. Si un paquet ne parvenait pas à sa destination finale, il serait rapidement retransmis depuis la source.
Des boîtes noires seraient utilisées pour connecter les réseaux ; elles seraient ensuite appelées passerelles et routeurs. Les passerelles ne conserveraient aucune information sur les flux individuels de paquets passant par elles, ce qui les rendrait plus simples et éviterait une adaptation et une récupération compliquées à partir de divers modes de défaillance.
Il n’y aurait pas de contrôle global au niveau des opérations.
D’autres questions clés devaient être abordées :
Des algorithmes pour empêcher les paquets perdus de désactiver définitivement les communications et permettre leur retransmission réussie à partir de la source.
Prévoir un « pipeline » d’hôte à hôte afin que de multiples paquets puissent être acheminés de la source à la destination à la discrétion des hôtes participants, si les réseaux intermédiaires le permettent.
Les fonctions de passerelle lui permettent de transmettre les paquets de manière appropriée. Cela inclut l’interprétation des en-têtes IP pour le routage, la gestion des interfaces, la division des paquets en plus petits morceaux si nécessaire, etc.
La nécessité de faire des sommes de contrôle de fin de chaîne, de réassembler les paquets à partir de fragments et de détecter les doublons, le cas échéant.
La nécessité d’un adressage global
Techniques de contrôle des flux d’hôte à hôte.
Interfaçage avec les différents systèmes d’exploitation
Il y avait aussi d’autres préoccupations, telles que l’efficacité de la mise en œuvre, la performance de l’internet, mais il s’agissait au départ de considérations secondaires.
M. Kahn a commencé à travailler sur un ensemble de principes de systèmes d’exploitation axés sur la communication alors qu’il était à BBN et a documenté certaines de ses premières réflexions dans un mémorandum interne de BBN intitulé « Communications Principles for Operating Systems ». Il a alors réalisé qu’il serait nécessaire d’apprendre les détails de la mise en œuvre de chaque système d’exploitation pour avoir une chance d’intégrer tout nouveau protocole de manière efficace. Ainsi, au printemps 1973, après avoir commencé l’effort d’internalisation, il a demandé à Vint Cerf (alors à Stanford) de travailler avec lui sur la conception détaillée du protocole. Vint Cerf avait été intimement impliqué dans la conception et le développement du PCN initial et possédait déjà les connaissances nécessaires à l’interfaçage avec les systèmes d’exploitation existants. Ainsi, forts de l’approche architecturale de Kahn en matière de communications et de l’expérience de Cerf dans le domaine des PCN, ils ont fait équipe pour préciser les détails de ce qui est devenu le TCP/IP.
Les échanges ont été très productifs et la première version écrite7 de l’approche résultante a été distribuée lors d’une réunion spéciale du groupe de travail international sur les réseaux (INWG) qui avait été créé lors d’une conférence à l’université du Sussex en septembre 1973. Le Cerf avait été invité à présider ce groupe et a profité de l’occasion pour organiser une réunion des membres du INWG qui étaient fortement représentés à la conférence du Sussex.
Quelques approches fondamentales ont émergé de cette collaboration entre Kahn et le Cerf :
La communication entre deux processus consisterait logiquement en un très long flux d’octets (ils les ont appelés octets). La position de tout octet dans le flux serait utilisée pour l’identifier.
Le contrôle du flux se ferait à l’aide de fenêtres coulissantes et d’accusés de réception (acks). La destination pourrait choisir le moment de l’acquittement et chaque ack renvoyé serait cumulatif pour tous les paquets reçus jusqu’à ce point.
La question de savoir exactement comment la source et la destination s’accorderaient sur les paramètres du fenêtrage à utiliser a été laissée ouverte. Les paramètres par défaut ont été utilisés au départ.
Bien qu’Ethernet soit en cours de développement chez Xerox PARC à l’époque, la prolifération des réseaux locaux n’était pas envisagée à l’époque, et encore moins les PC et les stations de travail. Le modèle initial était constitué de réseaux de niveau national comme ARPAnet, dont on ne prévoyait qu’un nombre relativement faible. Une adresse IP de 32 bits a donc été utilisée, dont les 8 premiers bits représentaient le réseau et les 24 bits restants désignaient l’hôte de ce réseau. Cette hypothèse, selon laquelle 256 réseaux seraient suffisants dans un avenir prévisible, devait manifestement être reconsidérée lorsque les réseaux locaux ont commencé à apparaître à la fin des années 70.