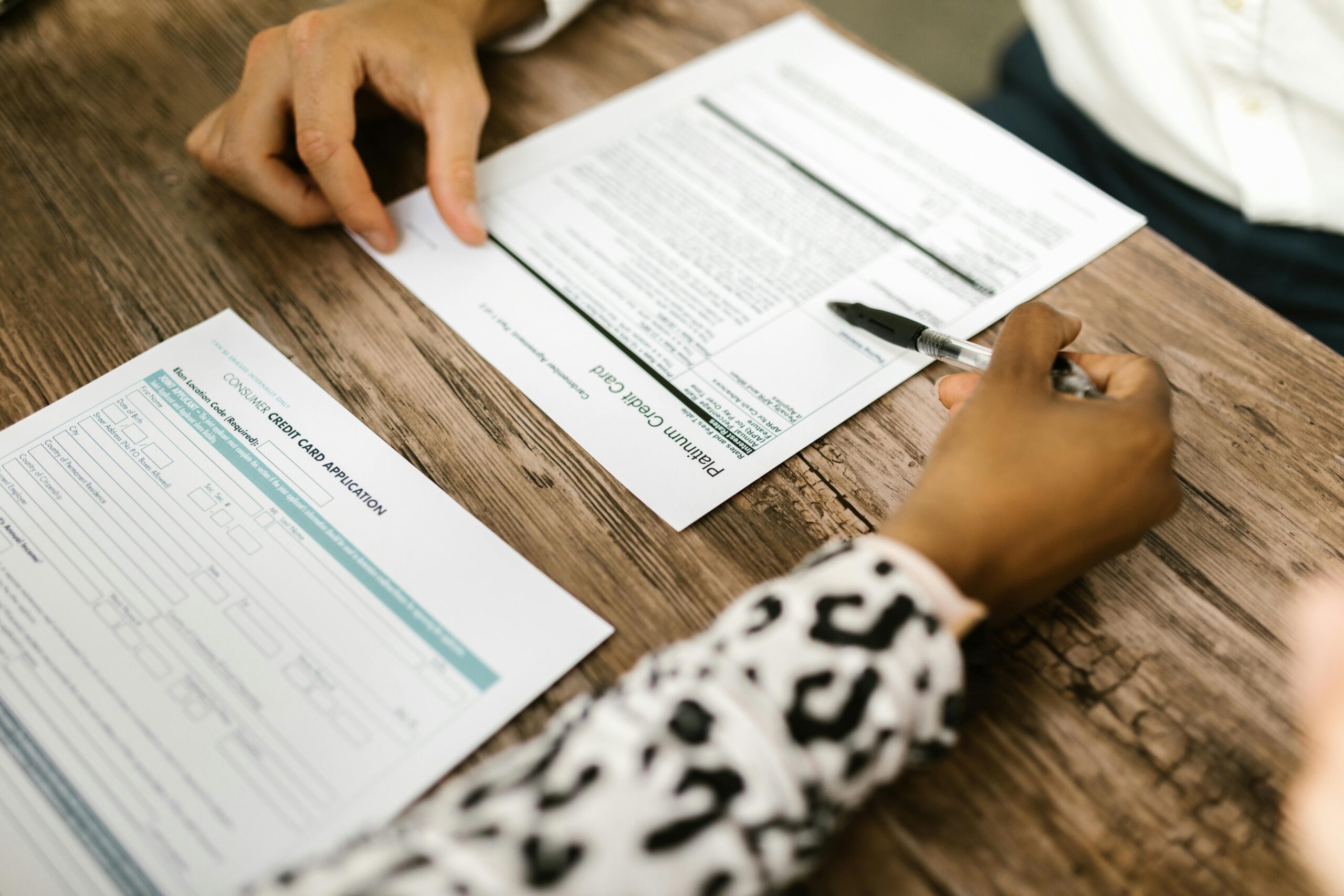1. Les origines ferroviaires de Genève (milieu du XIXᵉ siècle)
À l’aube de l’ère industrielle, Genève est encore relativement isolée sur le plan ferroviaire. Malgré son ouverture au commerce par le lac Léman et ses liens étroits avec la France, la ville n’est pas encore connectée au réseau ferroviaire national suisse. À partir des années 1850, des débats intenses animent les milieux politiques et économiques pour déterminer le tracé d’un chemin de fer reliant Genève aux grandes lignes européennes.
En 1858, la première liaison ferroviaire entre Genève et Lyon est établie par la Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève. Mais à ce moment-là, la ville ne dispose pas encore de véritable gare : les voyageurs arrivent sur un quai rudimentaire situé à l’extérieur de la ville, dans le quartier de Cornavin, encore peu urbanisé.
2. Une première gare rudimentaire (1858–1870)
La première structure qui tient lieu de gare est une construction modeste, faite de bois et de tôle, avec quelques quais et un abri pour les passagers. Cette gare provisoire répond à l’urgence du moment, mais devient vite insuffisante face à l’augmentation du trafic ferroviaire.
Dans les années suivantes, les premières liaisons vers Lausanne, Neuchâtel et la Suisse alémanique sont mises en place. Genève devient peu à peu un carrefour stratégique, autant pour les voyageurs que pour les marchandises. La nécessité d’un bâtiment digne de ce nom se fait sentir.
3. Construction de la gare monumentale (1870–1902)
Entre 1870 et 1883, la ville entreprend la construction d’un nouveau bâtiment pour la gare, plus vaste, plus fonctionnel et surtout plus représentatif de la Genève en plein essor. C’est l’architecte Adolphe Bernard qui conçoit le projet : un édifice de style néo-Renaissance, avec une large façade symétrique, une verrière couvrant les quais, un grand hall voyageur, des guichets en bois sculpté, une salle d’attente séparée par classe sociale, et un buffet devenu rapidement célèbre.
Un élément marquant du bâtiment est la tour horloge, visible depuis le centre-ville, qui deviendra un repère emblématique. Le nom « Cornavin » désigne alors à la fois le quartier et la gare, renforçant l’identité de cette nouvelle polarité urbaine.
4. Croissance du trafic et transformation du quartier (1900–1930)
À mesure que les lignes se multiplient (vers la Suisse, la France, et plus tard vers l’Italie), la gare s’impose comme un lieu stratégique, non seulement pour Genève mais pour toute la région lémanique. Le quartier de Cornavin, autrefois périphérique, devient un pôle d’attractivité. On y construit des hôtels, des commerces, des entrepôts et des logements pour les cheminots.
L’électrification des lignes commence au début du XXᵉ siècle. Elle transforme l’aspect technique de la gare : les caténaires sont installés, de nouvelles sous-stations électriques sont construites, et le transport devient plus rapide et fiable.
5. Une gare au cœur des conflits mondiaux (1939–1945)
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Genève reste neutre, mais la gare de Cornavin joue un rôle discret mais important dans les échanges humanitaires et le transit de personnes réfugiées ou déplacées. Elle est également un point de passage pour des diplomates, des organisations internationales et des convois de la Croix-Rouge. Malgré le contexte tendu, la gare n’est pas touchée par les bombardements.
6. Modernisation de l’après-guerre (1950–1980)
Après la guerre, le bâtiment est vieillissant. Les autorités engagent une vaste opération de modernisation. Le buffet d’origine est démoli pour laisser place à un hall plus vaste et lumineux. Les quais sont rallongés pour accueillir des trains plus longs. L’architecture intérieure évolue : les boiseries disparaissent, remplacées par des matériaux plus fonctionnels comme le béton, le verre et l’acier.
Le quartier autour de la gare évolue lui aussi, accueillant plus d’hôtels, de commerces, et devenant un lieu de transit très fréquenté.
7. L’arrivée du TGV et l’ouverture internationale (1980–2000)
L’inauguration du TGV Lyria dans les années 1980 marque un tournant. Genève est désormais reliée à Paris en quelques heures. Cela transforme Cornavin en gare internationale de premier plan.
Les quais sont partiellement réorganisés, les services sont adaptés à une clientèle plus internationale : signalétique multilingue, boutiques duty-free, salons d’attente premium. Le volume de passagers augmente considérablement.
8. CEVA, Léman Express et la gare souterraine (2010–2020)
Le projet CEVA (Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse) est l’un des plus ambitieux jamais réalisés à Genève. Il s’agit de relier les deux rives du canton et d’ouvrir l’agglomération vers la Haute-Savoie. Cornavin devient ainsi le point d’articulation du Léman Express, plus grand réseau ferroviaire régional transfrontalier d’Europe.
Une partie de la gare est repensée en sous-sol : de nouveaux quais souterrains sont creusés, des accès directs vers les trams et les bus sont mis en place, et une nouvelle galerie marchande est intégrée au dispositif. Le chantier, complexe et coûteux, transforme la gare en véritable hub multimodal.
9. Un pôle du XXIᵉ siècle en constante évolution
Aujourd’hui, la gare Cornavin accueille plus de 200 000 voyageurs par jour. Elle est un carrefour stratégique entre le rail suisse, le Léman Express, les TGV, les trams, les bus et les mobilités douces.
Des projets d’agrandissement sont toujours en cours, notamment l’ajout de nouveaux quais pour désengorger le trafic, et la requalification complète de l’espace public autour de la place de Cornavin. L’objectif est d’allier efficacité des transports, qualité architecturale, et confort pour les voyageurs.
Cornavin, au fil de son histoire, est passée du statut de gare de campagne à celui de plateforme métropolitaine. Elle incarne à la fois la mémoire ferroviaire genevoise et son avenir connecté au monde.