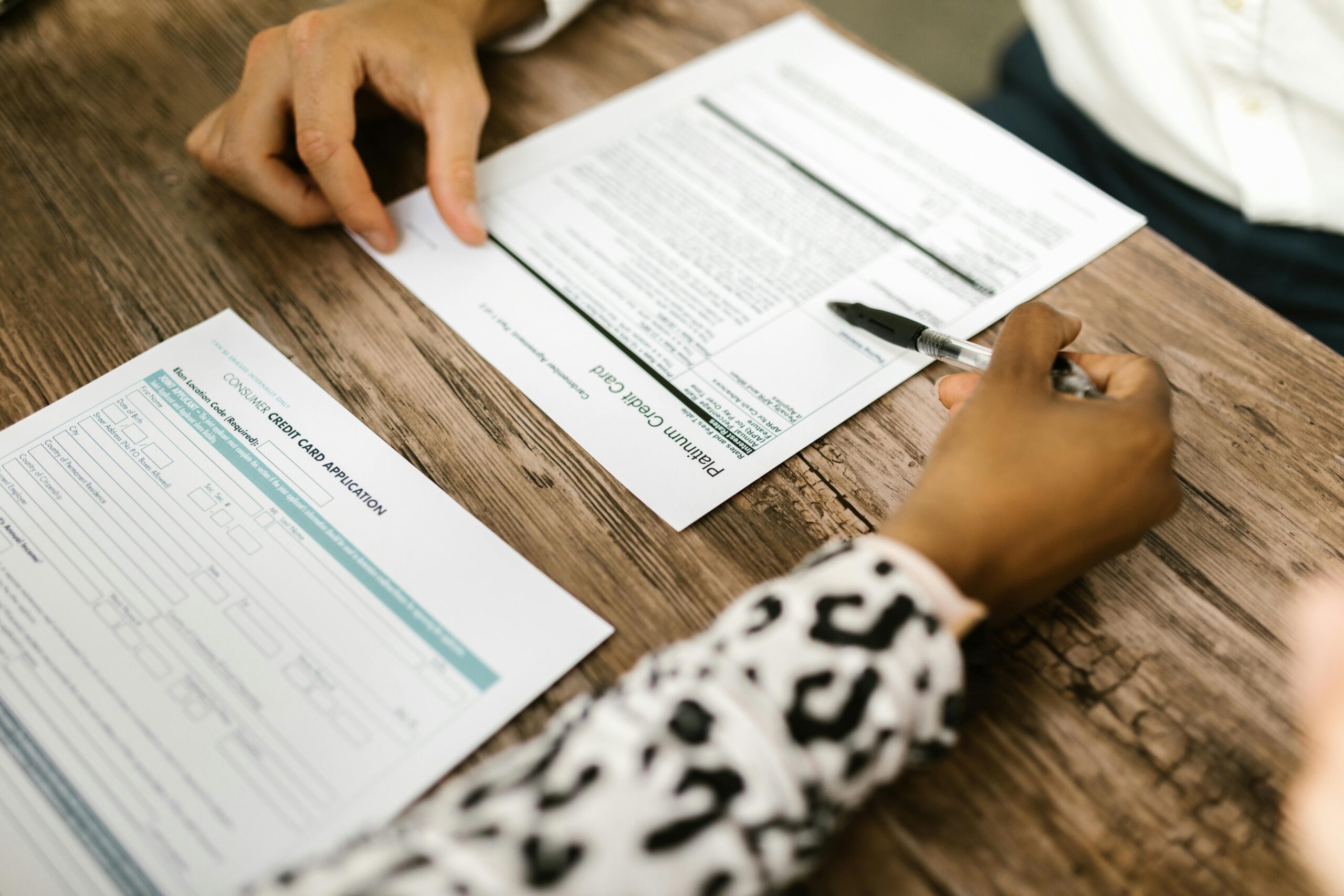L’année 2014 a marqué deux anniversaires importants dans l’évolution des technologies de l’information. Il y a quarante-cinq ans (le 29 octobre 1969), le premier lien ARPAnet (qui sera plus tard connu sous le nom d’Internet) a été établi entre l’UCLA et SRI. Il y a vingt-cinq ans (mars 1989), Tim Berners-Lee a fait circuler une proposition de « Mesh » (qui sera plus tard connu sous le nom de World Wide Web) à sa direction au CERN.
Cette chronologie met en évidence les développements majeurs (et quelques développements mineurs) de l’évolution de ces deux fleurs jumelles de l’ère numérique, l’une (l’Internet) une infrastructure de réseau, l’autre (le Web) une infrastructure logicielle superposée. Ensemble, elles ont jusqu’à présent connecté plus d’un tiers de la population mondiale et ont fait de millions de personnes à la fois de nouveaux consommateurs et de nouveaux créateurs d’informations.
Trois thèmes ou tensions clés découlent de cette très courte histoire de l’Internet et du Web : 1. Centralisation vs. décentralisation des ressources et des connaissances ; 2. application d’une taxonomie préconçue à un ensemble de connaissances vs. auto-organisation par le biais de liens associatifs ; 3. consommation à sens unique vs. consommation et création de connaissances à double sens. De manière plus générale, il s’agit d’une bataille entre systèmes fermés/propriétaires et ouverts/universels, une lutte permanente qui façonnera l’avenir de l’Internet et du Web.
1728 Ephraim Chambers, un globe-trotter londonien, publie la Cyclopédie, ou, un Dictionnaire universel des arts et des sciences. C’est la première tentative de relier par association tous les articles d’une encyclopédie ou, plus généralement, toutes les composantes de la connaissance humaine.
Pourquoi les dirigeants devraient-ils cesser d’être obsédés par les plateformes et les écosystèmes ?
Quel est l’impact de la technologie sur la main-d’œuvre actuelle ?
Pourquoi l’avenir du monde des affaires consiste-t-il à créer une valeur partagée pour tous ?
« Les anciens lexicographes n’ont rien tenté de semblable à Structure in their Works ; ils ne semblent pas non plus avoir eu conscience qu’un dictionnaire était dans une certaine mesure capable de présenter les avantages d’un discours continu. En conséquence, nous ne voyons rien de semblable à un Tout dans ce qu’ils ont fait…. Nous nous sommes efforcés d’atteindre cet objectif en considérant les différents sujets non seulement de manière absolue et indépendante, mais aussi de manière relative ou dans le respect mutuel. Ils sont tous deux traités comme autant de tout, et autant de parties d’un tout plus grand ; leur lien avec celui-ci est souligné par une référence… Une communication est ouverte entre les différentes parties de l’oeuvre ; et les différents articles sont dans une certaine mesure replacés dans leur ordre naturel de science, dont l’ordre technique ou alphabétique les avait retirés.
1910 Les juristes et bibliographes belges Paul Otlet et Henri La Fontaine proposent un dépôt central pour la connaissance du monde, organisé par la Classification décimale universelle. Le Mundaneum abritera à terme plus de 15 millions de fiches, 100 000 fichiers et des millions d’images. En 1934, Otlet fruther avance sa vision de la bibliothèque rayonnée, dans laquelle les gens du monde entier passeront des appels téléphoniques à son « cerveau mécanique et collectif » et recevront des informations en retour sous forme de signaux de télévision.
Février 1966 Robert Taylor devient le directeur du Bureau des techniques de traitement de l’information (IPTO). Il propose à son patron l’ARPAnet, un réseau qui reliera les différents projets que l’ARPA sponsorisait. À l’époque, chaque projet disposait de son propre terminal spécialisé et d’un ensemble unique de commandes utilisateur.
Début 1967 Lors d’une réunion des chercheurs principaux de l’ARPA à Ann Arbor, dans le Michigan, Larry Roberts, le responsable du programme de réseau de l’ARPA, propose son idée d’un ARPAnet distribué par opposition à un réseau centralisé géré par un seul ordinateur. La proposition de M. Roberts, selon laquelle tous les ordinateurs hôtes se connecteraient directement les uns aux autres, faisant double emploi en tant qu’ordinateurs de recherche et routeurs de réseau, n’a pas été approuvée par les chercheurs principaux, qui étaient réticents à consacrer des ressources informatiques précieuses à l’administration du réseau. Après la fin de la réunion, Wesley Clark, un informaticien de l’université de Washington à St. Louis, a suggéré à M. Roberts que le réseau soit géré par de petits ordinateurs identiques, chacun étant relié à un ordinateur hôte. Acceptant l’idée, Roberts a nommé les petits ordinateurs dédiés à l’administration du réseau « Interface Message Processors » (IMPs), qui ont ensuite évolué pour devenir les routeurs actuels.